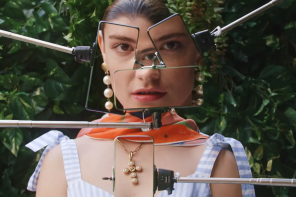« Eprise de la fleur ». La signification de « Golshifteh », en persan, est riche de sens. Lorsque Fahimeh Rahminia et Behzad Farahani le donnent à leur fille, ils aspirent à une douceur semblable. Car, comme l’écrit le poète Rûmi, que la famille aime tant : « Ce n’est pas l’orage qui fait pousser les fleurs, c’est la pluie ».
L’enfant chérie de l’Iran
Golshifteh Farahani naît à Téhéran, le 10 juillet 1983. Fille d’une actrice et d’un metteur en scène reconnu, elle grandit dans un milieu artistique. Elle baigne dans la peinture, la musique, et les films, grâce aux DVDS échangés sous le manteau, le cinéma étant alors restreint par la République islamique. A peine contrainte par les interdits des mollahs, ces érudits de l’islam qui ont pourtant tout pouvoir en Iran, depuis la révolution de 1979, sa vie est faite de théâtres et de fêtes clandestines.
Dès l’âge de 6 ans, Golshifteh est une virtuose du piano, et intègre vite une école de musique. Elle interrompt sa carrière musicale à l’âge de 15 ans, après avoir tourné le premier film de sa vie. Le Poirier, réalisé par Dariush Mehrjui, en 1998, la propulse au rang de star nationale en Iran. Elle incarne « M », l’amour de jeunesse de Makhmoud, un écrivain iranien très célèbre. Sa carrière est lancée. Entre 1998 et 2008, elle tourne non pas moins de 19 films.
Adolescente, alors qu’elle marche dans la rue, un passant lui jette de l’acide parce qu’elle n’était, soi-disant, « pas assez couverte ». Elle en sort indemne, protégée par son manteau et son sac. Le signe n’en est pas moins clair : elle ne peut vivre en paix en Iran.

La trahison à Hollywood
« Le diable au corps », dirait les mollahs, Golshifteh Farahani multiplie les tournages, y compris à l’étranger. Notamment avec le film de Ridley Scott, Mensonges d’Etat, où elle partage l’affiche au côté de Leonardo DiCaprio. Elle incarne Aïcha, une infirmière, qui rencontre Rogger Ferris, agent de la CIA traquant un leader d’Al-Qaïda en Jordanie.
Première actrice iranienne à se produire à Hollywood depuis la révolution islamique, elle s’attire les foudres des islamistes iraniens. A son retour, son passeport est confisqué : elle n’a plus l’autorisation de quitter le territoire. Une assignation à résidence à laquelle l’actrice ne peut se résoudre. Elle obtient des mollahs le droit de se rendre à New York, pour la première américaine du film, où elle apparaît les cheveux découverts.
L’actrice vit sous le contrôle des autorités iraniennes. Les services secrets exigent d’elle qu’elle leur fasse lire les scénarios qu’elle reçoit. Elle doit répondre de tout, y compris de l’action ou du comportement des personnages qu’elle incarne : porte-t-elle le voile ? Pourquoi est-elle nue ? Pourquoi embrasse-t-elle le personnage ?

Vie d’exilée
Quel est le rapport entre Rêves, le classique japonais réalisé par Akira Kurosawa en 1990, le film Dheepan, de Jacques Audiard, sorti en 2015, et Parasite de Bong Joon Ho, palme d’or du Festival de Cannes en 2019 ? Tous sont cités par Golshifteh Farahani. Pour elle, ils représentent le mieux l’expérience de l’exilé. Lorsque l’actrice reprend l’avion pour tourner le There be Dragons de Roland Joffé, en 2010, elle sait que c’est un aller simple. Elle quitte l’Iran pour toujours.
L’exil, telle qu’elle le vit, est moins politique que social. Comme dans Dheepan, qui raconte l’histoire d’une famille sri lankaise immigrée en France, et traite des difficultés d’intégration des exilés, perçus comme des « aliens » par la population.
Social, l’exil est aussi « exil de soi », raconte l’actrice. Et de citer Rêves et Parasite,parce qu’ils mettent en scène des personnages « privés » de leur identité. Lorsqu’après la scène du massacre, Ki-taek, le père de famille de l’œuvre de Bong Joon Ho, disparaît, l’expérience qu’il vit est celle de l’exilé, explique-t-elle. Caché dans cette cave, privé de foyer, de langage même, puisque le personnage ne communique plus qu’en morse, Ki-taek perd son identité.
Golshifteh Farahani ne vit pas autre chose lorsqu’elle quitte son pays. Elle emménage brièvement aux Etats-Unis, puis se rend à Paris mais ne s’y plait pas non plus. Elle pense à l’Australie ou encore à l’Egypte. Ce foyer qu’elle a quitté, que ses parents rêvaient idyllique et où elle s’était épanouie, elle ne le retrouve nulle part ailleurs. Pas même en Iran.
Aucun drapeau
De quoi Golshifteh Farahani est-elle le nom ? De la souffrance perpétrée par l’extrémisme islamiste ? Difficile à croire, venant de celle qui a quitté les Etats-Unis justement pour ne pas s’enfermer dans un rôle de « Moyen-Orientale », éternelle rengaine des scénaristes américains qui ne lui aurait proposé que des rôles de « terroriste » ou « d’espionne ». Du féminisme et de l’affirmation des droits de la femme ? Sans doute, à ceci près que l’actrice a, plusieurs fois, exprimé quelques réticences quant au mouvement « Metoo », lancé en octobre 2017 après le scandale de « l’affaire Weinstein », dont elle regrette l’aspect « air du temps ».
Golshifteh Farahani incarne pourtant bel et bien les valeurs de l’antisexisme. Ni son discours ni sa pensée ont fait d’elle le symbole qu’elle est aujourd’hui. Mais sa vie, et son existence même, sont toutes entières tournées, non pas contre l’oppression, mais vers un bonheur beaucoup plus commun. Vers la pluie qui, seule, fait pousser les fleurs.
Pierre-Yves Georges