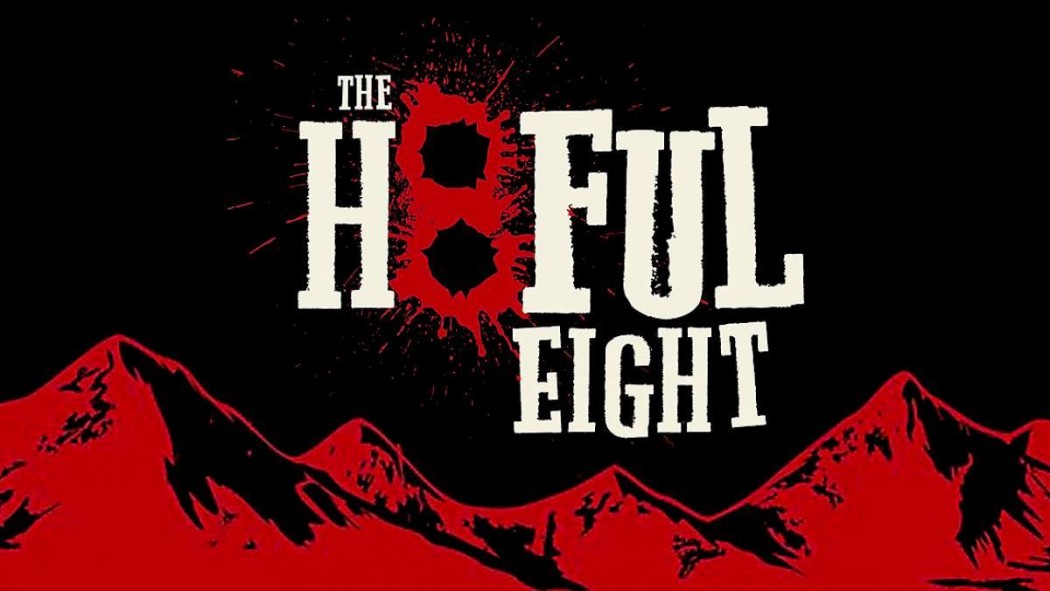The Hateful Eight : le huit clos tragique façon Tarantino
The Hateful Eight, le petit dernier de Quentin Tarantino marquera sa filmographie tant par les passions qu’il déchaîne parmi les critiques que par sa réalisation, et ce dès les premières images. Rappelons cependant rapidement le scénario : John Ruth (dit le Bourreau) emmène sa prisonnière, Daisy Domergue à travers le Wyomming afin qu’elle se fasse pendre. Ils rencontrent successivement le Major Marquis Warren, lui aussi chasseur de prime, ainsi que Chris Mannix, nouvellement nommé shérif. De crainte d’être pris dans le blizzard, ils font halte dans une auberge tenue par un certain Bob « le Mexicain », où résident déjà trois autres voyageurs : Joe Gage, Oswaldo Mobray et le Général Sandy.
Une succession de plans sur des paysages enneigés ouvre le film, jusqu’au long et obsédant plan séquence, détaillant un Christ en croix le long d’une route qu’une diligence emprunte. Déjà, le temps se calque sur le rythme de la musique composée spécialement par Ennio Morricone. Inhabituel pour Tarantino qui a l’habitude d’emprunter au répertoire contemporain la bande son de ses films. Le thème revient à plusieurs reprises dans le film, comme un rappel de ce Christ en souffrance, noyé sous la neige. Dans ces premières minutes, cette musique aux airs de Dies Irae (1) donne le ton : digne d’une musique de film d’horreur, l’angoisse nous saisit sans raison à l’annonce de la noirceur du film. Et tout le paradoxe réside dans le décalage entre les images et la musique : paradoxe que l’on retrouve dans d’autres scènes du film comme une volonté de signaler au spectateur que la violence et la mort sont omniprésentes dans ce film.
La suite du film se déroule par chapitre. Cette construction inattendue, surtout pour un western, permet de faire monter les attentes du spectateur, jusqu’au deux derniers chapitres qui contiennent le dénouement des tensions – qui se fait dans la mort – ainsi que la résolution de l’intrigue. Une construction classique, voire très classique, que l’on doit à la tragédie grecque. Ces chapitres rythment le film au lieu de le ralentir puisque le huit clos et ses unités de temps et de lieu imposent au scénario de faire entrer le spectateur dans le temps du film. Un effet qui évite au spectateur de sentir les 2h47 de film passer et même de donner au film un temps long sans longueurs.
Encore une fois, Tarantino fait dans l’originalité en couplant scénario type Cluedo (qui sera le prochain tué et par qui ?) au cadre plus classique d’un western à la tension palpable. Le mélange fonctionne bien, voire très bien, grâce à des personnages bien travaillés. S’ils obéissent tous à des rôles précis et typiques (bourreau-gentleman, aubergiste bourru, shérif puéril, soldat de la guerre de Sécession), leurs personnalités méprisables ou risibles en font des pièces maîtresses de l’intrigue. Tous obéissent à la loi du « tous pourris » : leurs principales qualités étant d’être racistes, sans foi, ni lois. Ce que nous montre ici Tarantino est un western avec brutes et truands, sans bons quelconques pour relever le niveau moral. Il est à souligner que tous les acteurs sont ainsi habités par leur rôle. Il faut bien sûr souligner la performance – une fois de plus – de Samuel L. Jackson en chasseur de prime sans scrupule à la gâchette facile, ainsi que celle de Walton Goggins dans le rôle d’un shérif hilarant bien trop sûr de lui.
Rien n’est fade dans ce film, jusqu’au ton, où l’on retrouve bien là l’esprit des films de Tarantino. De l’humour au millième degré, qui va parfois jusqu’à l’absurde tant il est excessif. Un humour dont la réussite est qu’il ne parvient pas, malgré tout, à lever la pesanteur et la tension de l’atmosphère. De même que l’outrance et le grotesque des morts que trouvent les personnages. Toujours l’hémoglobine que l’on reproche à Tarantino et qui pourtant permet de ne pas trouver au film ce ton pessimiste et pourquoi pas moralisateur que l’on pourrait y trouver sans ces bouffonneries. Exagération qui n’est pas sans rappeler ses premiers films comme Reservoir Dogs, notamment dans les agonies sans fin des personnages.
Pour conclure, il s’agit là d’un film déroutant, qui marque, si ce n’est une rupture, un renouveau dans la filmographie de Tarantino. Si l’on retrouve des éléments récurrents (le sang versé au litre, les dialogues à l’acide et la présence inénarrable de Samuel L. Jackson), d’autres nouveautés soufflent un vent de fraîcheur sur la filmographie de Tarantino qui ne décevra ni ses fans ni les novices.
Julie Andreotti
Les 8 salopards : Quel bastard a rajouté du ketchup dans le ragoût ?
Le nouveau Tarantino ne peut pas décevoir ceux qui ont appréciés ses précédents films. Tout ce pourquoi on a aimé Django Unchained, Kill Bill ou Reservoir Dogs à savoir la violence esthétisée, la densité de la tension dramatique, le cynisme parodique ou le goût des contrastes est là, prêt à être dégusté. Minnie est censée être partie il y a une semaine, et pourtant, le major marquis Warren est formel : il n’y a qu’elle qui peut avoir cuisiné un tel ragoût. Ses talents de gastronome aguerrie amorcent un huis clos savoureux et sanglant.
Au Gaumont Marignan, The Hateful Height (2 heures et 45 mn) débute, mais pas vraiment. Seul un grand mot « Ouverture » se détache pendant plusieurs minutes sur un bandeau rouge sang. La lumière faiblit tout à coup. Quentin Tarantino s’offre en effet le luxe de différer l’intrigue, mais on ne s’ennuie pas. Il donne au public, sans qu’il s’en rende compte, une possibilité de porter un regard réflexif sur sa position de spectateur. Dans ce moment où le film commence, mais pas tout à fait, on apprécie la musique d’Ennio Morricone et le format de pellicule 70 mm qui n’avait pas été utilisé depuis 1966 : ils font de cette projection un véritable spectacle. Quentin Tarantino exhume pour notre plus grand plaisir des acteurs des années 1980 et 1990 qui n’ont pas pris une ride : notamment Kurt Russell et Samuel L.Jackson dans la peau de deux chasseurs de primes, un Walton Goggins jubilatoire et Michael Madsen, le cowboy droit dans ses bottes. Avec eux, il use jusqu’à la corde les codes de représentation du cinéma.
Cependant, la recette éclectique qu’il chérit ne sert pas une violence gratuite, ou de l’humour facile. En effet, Tarantino se permet des finesses insoupçonnées dans le traitement d’éléments vus et revus dans les westerns. Il parvient à soutenir un rythme narratif rapide faisant honneur au genre tout en ménageant des scènes de table inoubliables. Aussi, on se repaît du morceaux de bravoure grotesque qui consiste à tendre une corde jusqu’aux toilettes. Le réalisateur nous adresse malicieusement des clins d’œil : le bourreau fait part de ses réflexions triviales sur la justice à sa prochaine victime et à John Ruth, surnommé lui-même le Bourreau. Tarantino joue avec nos nerfs en laissant une grande place aux scènes dialoguées qui diffèrent la violence et l’introduisent : le cynique Marquis Warren expose par le menu au vieux sudiste les humiliations qu’il a faites subir à son fils avant de l’achever. En structurant son film par chapitres, Tarantino fait un pied de nez à l’effet de réel dans lequel le spectateur se coule avec délice lorsqu’il est devant un blockbuster. Il ne veut pas embarquer le spectateur dans une histoire, mais le malmener, le scandaliser, susciter sa curiosité et chambouler ses habitudes. Une jeune fille charmante se fait tuer de sang froid mais la scène est étonnamment stylisée : un bocal de bonbons colorés éclate au même instant entre ses mains. Notre sensibilité de spectateur est de fait mise à rude épreuve : on ne sait plus ce que l’on doit regarder ni comment le regarder. Ici et là, du sang gicle et jaillit en joyeuses gerbes des corps perforés de balles. Mais des contusions peuvent aussi apparaître insidieusement sur la figure de Daisy Domergue, (Jennifer Jason Leigh), une des salopards qu’on emmène se faire pendre, au fur et à mesure des raclées qui lui sont administrées. Provocateur, ce virtuose de l’esbroufe privilégie le geste créateur plus que la fidélité à un référentiel historique donné. Les 8 salopards démontre encore une fois que Tarantino ne prétends pas représenter une réalité : il produit du réel dans l’espace de liberté crée devant la caméra par les techniques de montage , la musique, les effets spéciaux, les contrastes de couleurs, les plans séquences structurés.
Les 8 salopards du 8ème film de Tarantino se renvoient les balles avec fulgurance et cynisme : n’essayez pas d’arbitrer, ça tourne au vinaigre ! // Soyez malin, mettez vous au premier rang !
Marie-Sophie Listre